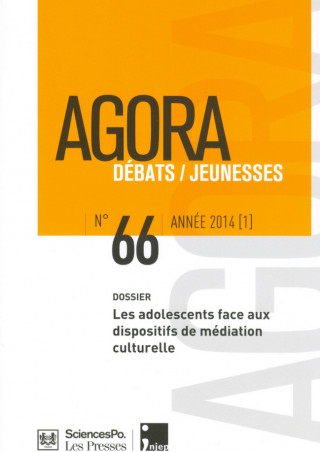
Bien que très investis dans les pratiques et consommations culturelles, nombre d’adolescents disparaissent, dès 12 ans, des structures et dispositifs mis à leur disposition : conservatoires, centres de loisirs et de vacances, médiathèques, etc. Comprendre cette désaffection partielle, mais aussi, à rebours, la réussite de certains dispositifs, demande d’articuler deux niveaux d’interrogation que ce numéro de la revue essaye d’analyser.
Ces jeunes qui, même dans une conjoncture favorable, n’y arrivent pas
Madeleine Gauthier
« Par quoi commencer ? », se demandent des intervenants dans un groupe de discussion à propos de jeunes aux prises avec des difficultés multiples et complexes. Cette rencontre qui s’est réalisée en 2008 fait partie d’une démarche de recherche en partenariat suscitée par le constat que, même en période de prospérité comme c’est alors le cas pour la ville de Québec, des jeunes adultes n’arrivent pas à trouver d’emploi et les moyens d’assurer leur autonomie. Comment expliquer ce phénomène lorsque le recours aux facteurs structurels habituels ne répond pas et comment réagir dans ce contexte ?
Par le petit bout de la lorgnette
Les politiques publiques de jeunesse en Belgique francophone vues
sous l’angle des services d’information des jeunes Jean-François Guillaume
Dans le champ des politiques publiques en Belgique francophone, l’information des jeunes n’occupe qu’une place très marginale. Mais à considérer d’un peu plus près cet objet faussement mineur, on y perçoit les tensions générées par les nouvelles orientations de l’action publique. Dans un paysage institutionnel complexe, les travailleurs des centres d’information de jeunesse doivent parvenir à concilier un principe de participation des jeunes, hérité des aspirations d’émancipation sociale des années 1960, et une injonction de professionnalisation dans un secteur où les évolutions technologiques ont bouleversé les pratiques juvéniles.
Les adolescents face aux dispositifs de médiation culturelle
Un dossier coordonné par Chantal Dahan, Francine Labadie et Sylvie Octobre
Introduction
Pensés et impensés des médiations culturelles pour les adolescents
Chantal Dahan, Francine Labadie, Sylvie Octobre
Malentendus et désaccords sur le plaisir cinématographique
La réception de Lycéens et apprentis au cinéma par les jeunes rhônalpins
Tomas Legon
Créé par le Centre national du cinéma et les Régions, Lycéens et apprentis au cinéma (LAC) est un dispositif qui permet à des élèves de voir trois films en salle et de profiter d’une « éducation à l’image ». L’article vise à éclairer comment les différents jeunes qui bénéficient du dispositif en Rhône-Alpes le perçoivent. Cette étude de la réception est un moyen idéal pour comprendre, notamment, comment un travail de médiation qui vient des institutions parvient ou non à créer des effets sur une pratique culturelle déjà massivement et ordinairement investie par les adolescents.
Cultures juvéniles et bibliothèques publiques
Lier récréation et espace culturel
Mariangela Roselli
Dressant une ethnographie des usages juvéniles des bibliothèques, l’article repère les codes comportementaux associés à l’acte de lire comme autant de composantes d’un rapport négatif à la lecture que produit le lieu : règle du silence, injonction à la solitude, capacité à s’enfermer et à rester immobile, présupposé d’autonomie, volonté de concentration. Sur la base de ces constats, cette étude invite les bibliothèques à offrir une scène d’expérimentation dynamique de formes culturelles et sociétales plus conviviales et récréatives, plus permissives et audacieuses de manière à se distinguer des institutions de la culture consacrée.
Le rapport des élèves de milieux favorisés à la culture scolaire
Le cas de l’éducation musicale au collège
Florence Eloy
Le cas des savoirs musicaux scolaires, exemple emblématique de « savoirs gratuits », illustre bien l’ambiguïté du rapport à la culture scolaire que peuvent entretenir les élèves de milieux favorisés. Si l’on observe une plus grande proximité de ces élèves aux rapports à la musique visés par l’école, cela n’est pas forcément associé à une plus grande adhésion ou croyance aux savoirs musicaux scolaires, la tendance inverse étant particulièrement fréquente au sein de cette population. Ce phénomène peut être rapporté à l’attitude distanciée vis-à-vis de la culture scolaire décrite chez les « héritiers » pour les élèves les plus dotés en capital culturel, mais aussi, parmi les adolescents issus des franges moins « cultivées » des milieux favorisés, à des formes d’utilitarisme scolaire, compte tenu de la place marginale de l’éducation musicale dans les curricula.
Musées et adolescents : l’impossible médiation ?
Une enquête à l’intérieur et autour du Centre Pompidou
Maylis Nouvellon, Anne Jonchery
L’offre muséale à destination des adolescents se développe le plus souvent dans un cadre scolaire ou périscolaire. Or, une enquête réalisée à Paris auprès d’adolescents très familiers ou peu familiers des musées (à l’intérieur du Centre Pompidou et à l’extérieur, dans le quartier des Halles) met en lumière deux rapports à la pratique de visite du musée, selon que celle-ci s’intègre au cercle familial et amical ou seulement au contexte scolaire, questionnant alors la construction du lien et l’attachement à la pratique. Des dispositifs de médiation intégrant les spécificités des cultures adolescentes révèlent la possibilité que cette pratique s’inscrive dans l’agenda des loisirs adolescents.
Construire une offre de loisirs avec les adolescents
Étude d’un dispositif expérimental de la CNAF
Benoît Céroux, avec la collaboration de Christiane Crépin
La politique familiale intègre aujourd’hui des objectifs concourant au bien-être des familles, parmi lesquels figurent les loisirs des adolescents. Le contenu des activités constitue, dans ce cas, moins la visée principale qu’un moyen d’action orienté vers les principes traversant l’ensemble des dispositifs. À la suite de travaux faisant ressortir le décalage des aspirations des adolescents, de leurs parents et des institutions, la branche Famille expérimente de nouvelles modalités de mise en place de loisirs pour les adolescents, associant ces derniers à l’élaboration des projets et intégrant un adulte référent à la démarche. Cet article articule la présentation des dispositifs des Allocations familiales à destination des adolescents et des études qui les accompagnent.
La prise en charge des spécificités adolescentes
par les politiques éducatives et culturelles des collectivités publiques
Françoise Enel
Le présent article est élaboré à partir d’une série d’études qualitatives sur les pratiques culturelles des jeunes et les politiques d’éducation artistique et culturelle réalisées par l’auteur à la demande de collectivités publiques (ministère de la Culture et de la Communication, INJEP, ACSE, conseil général de la Somme et mairie de Paris). Il vise à mettre en regard les transformations des pratiques culturelles des jeunes et les tentatives d’ajustement des politiques dans un contexte de sensibilisation croissante des collectivités territoriales au rôle de l’ouverture culturelle dans le maintien du lien social avec les jeunes.
Comptes rendus de lecture (Télécharger)
Atlas national des fédérations sportives 2019 Hors collection
Varia Agora débats / jeunesses
Jeunes, religions et spiritualités Agora débats / jeunesses
Jeunes et santé mentale : ressources et appropriations Agora débats / jeunesses
Les études… et à côté ? Les modes de vie des étudiant·e·s Agora débats / jeunesses