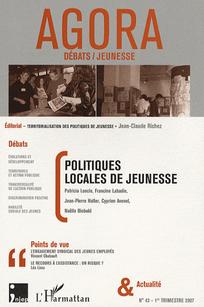
Au point de départ de ce numéro d’Agora, les Rencontres de Marly organisées par l’INJEP, les 7, 8 et 9 décembre 2005, autour du thème Douze ans de politiques territoriales de jeunesse 1993-2005. Il s’agissait alors de faire le point sur la territorialisation des politiques de jeunesse et le développement des politiques locales de jeunesse douze ans après une première manifestation.
Un dossier coordonné par Jean-Claude Richez, avec la collaboration de Chantal de Linares et Francis Lebon
Territorialisation des politiques de jeunesse (Télécharger)
Jean-Claude Richez
Évolutions des politiques locales de jeunesse
Patricia Loncle, enseignante-chercheuse à l’ENSP, département Politiss et Laboratoire d’analyse des politiques sociales et sanitaires
Le présent article a pour objectif de proposer une synthèse des évolutions qui affectent les politiques locales de jeunesse depuis une décennie. Pour ce faire, il s’intéresse aux changements qui concernent, d’une part, les problèmes publics définis par les politiques locales et, d’autre part, les niveaux d’intervention desdites politiques. Les politiques de jeunesse sont envisagées comme faisant partie d’un processus de complexification, de transversalisation de l’action publique, sur fond de désengagement de l’État. En procédant de la sorte, nous tentons de revenir sur l’hypothèse générale qui structure ce numéro : est-ce que les évolutions en matière de politiques locales de jeunesse vont dans le sens d’un développement des politiques territoriales ?
Politiques locales de jeunesse et territorialisation de l’action publique
Francine Labadie, chargée de mission à la Délégation au développement et aux affaires internationales, ministère de la Culture et de la Communication, ancien rapporteur de la commission « Jeunes et politiques publiques » au Commissariat général du Plan
L’auteur part des travaux réalisés par le Commissariat général du Plan pour analyser, à partir des dynamiques locales, l’action publique en direction des jeunes adultes à l’occasion de leur entrée dans les responsabilités économiques, sociales et politiques. Sont tour à tour examinées, dans une perspective cognitiviste, les représentations de la jeunesse convoquées à travers ces politiques, les conceptions des territoires mises en œuvre ainsi que leur imbrication. L’analyse mène à une interrogation sur la territorialisation en cours, laquelle risque d’aboutir à une exacerbation de la concurrence entre les différents niveaux d’intervention publique. Un repositionnement de chacun devient nécessaire, au sein duquel la Région pourrait être un échelon pertinent de médiation politique.
Politiques territoriales de jeunesse et transversalité
Jean-Pierre Halter, sociologue, directeur de l’association Méthodes et sciences humaines, chargé de recherche, d’études et de formation associé à l’INJEP
Impulsées par l’État, la contractualisation et la territorialisation de l’action publique en direction des jeunes ont eu un impact sur l’élaboration des politiques de jeunesse et suscité l’émergence de nouveaux acteurs institutionnels, professionnels et politiques. La transversalité de l’action publique se trouve ainsi au cœur d’une recomposition qui dessine une nouvelle répartition des pouvoirs entre l’État et ses représentants, les élus locaux et leurs techniciens, la sphère associative, ses militants et ses professionnels.
Politiques de jeunesse : universalité, ciblage ou « discrimination positive » ?
Cyprien Avenel, sociologue, chargé de mission à la CNAF, enseignant à l’IEP de Paris
L’auteur analyse la montée des dispositifs de ciblage, notamment en direction des jeunes, destinés à compenser les insuffisances des politiques de droit commun. En se référant à des exemples précis qui montrent l’incertitude des objectifs, des moyens et des résultats de ces dispositifs, l’auteur plaide pour leur inscription beaucoup plus conséquente au sein des politiques de droit commun. Une réelle discrimination positive devrait permettre aux usagers de s’approprier les politiques de droit commun, d’en être les acteurs et d’être considérés comme une ressource locale plutôt que comme une population déficitaire.
Parier sur l’habileté sociale des jeunes
Noëlle Diebold, psychologue clinicienne, socio-analyste, chargée de cours aux universités de Bourgogne, Paris-V et Paris-XII
Parier sur l’habileté sociale des jeunes, c’est se donner les chances, simultanément, du développement social et du développement de l’identité individuelle des jeunes. Cela nécessite, pour le monde des adultes, de s’attacher à connaître et reconnaître les compétences sociales des jeunes pour les mettre en œuvre dans les projets qu’ils construisent. Les jeunes mettent en œuvre naturellement ces compétences dans trois domaines, celui des proches, celui de l’organisation sociale instituée et celui de l’environnement social proche. Ce pari suppose aussi d’abandonner la logique actuelle de construction des projets centrée sur le manque pour développer une méthodologie adaptée aboutissant à la mise en œuvre de ces compétences sociales lors de la construction de projets sur un territoire donné.
Pour en savoir plus
Bibliographie – Politiques publiques de jeunesse : territorialisation, politiques locales
L’engagement syndical des jeunes employés
Vincent Chabault, doctorant en sciences sociales à l’ENS/EHESS, membre du laboratoire Cultures et sociétés urbaines, enseigne la sociologie à l’université Paris-Dauphine, participe au groupe Pratiques de travail et organisations/EHESS
Ce texte s’appuie sur une enquête menée auprès d’employés du grand commerce parisien et traite du rapport au syndicalisme et des formes de militantisme à travers une perspective générationnelle. Peu syndiqué, exposé aux emplois peu qualifiés, ce secteur professionnel devient parfois le théâtre de mobilisations. Des mouvements sociaux récents et l’apparition de nouveaux réseaux militants indiquent à la fois la formation d’une contestation sociale et la volonté que ce secteur soit plus largement couvert par le droit du travail. L’expansion, dans ce type d’entreprise, d’un salariat diplômé, en raison de la massification scolaire, du fort taux de chômage et de l’élévation du niveau de recrutement, laisse entrevoir des évolutions concernant les ressources disponibles pour l’action collective et la conception du syndicalisme.
Le recours à l’assistance : un risque ?
Léa Lima, sociologue, chargée de recherche et de formation à l’INJEP
Depuis le milieu des années 1990, au Québec, on assiste à un changement de paradigme dans le traitement des jeunes assistés sociaux dans un contexte de « chasse » aux dépenses sociales. Fondées sur le modèle de l’acteur rationnel, les mesures de prévention considèrent la demande d’assistance comme un « comportement à risque » devant être traité comme tel. Ce faisant, les politiques de prévention essentiellement tournées vers les jeunes apparaissent inscrites dans une rationalité de la responsabilité qui repose sur deux vertus morales cardinales : la prudence et la prévoyance. Du même coup, elles amènent à reconsidérer le droit à l’aide sociale sous l’angle de l’efficacité.
Livres
Comptes rendus de lecture
Droit et responsabilités : préparation au concours animateur, adjoint d’animation
Pierre-Brice Lebrun
Ados ambassadeurs de la loi
Henni Amar, Laurence Legagneux, Patricia Pierre, Michel Servely
Vers les métiers de l’animation et du sport : la transition professionnelle
Sous la direction de Jean-Pierre Augustin, ONMAS
Les recompositions culturelles : sociologie des dynamiques sociales en situation migratoire
Abdelhafid Hammouche
Parutions
Agenda (colloques, rencontres, événements)
Veille informative
Recherche / Études / Formations
Rapports officiels
Sur le web
Atlas national des fédérations sportives 2019 Hors collection
Varia Agora débats / jeunesses
Jeunes, religions et spiritualités Agora débats / jeunesses
Jeunes et santé mentale : ressources et appropriations Agora débats / jeunesses
Les études… et à côté ? Les modes de vie des étudiant·e·s Agora débats / jeunesses